Parisa Reza: l'Iran, entre histoire et romance
- انتشارات ناکجا

- 26 sept. 2021
- 4 min de lecture
Le premier roman de Parisa Reza, Les jardins de consolation, lui a valu le prix Senghor 2015. La traduction anglaise, elle, a été classée parmi les meilleurs livres de 2016 par le magazine américain Publishers Weekly.

Vous habitez depuis le début des années 80 en France, où vous êtes arrivée à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui vous a inspirée à écrire deux romans sur la transformation de la société iranienne de 1920 à la fin des années 70?
Cette époque est celle de ma famille. Le premier livre, qui se situe entre 1920 et 1953, représente les années de mes grands-parents, puis celles de mon père, qui a vécu les années 50. Le deuxième roman représente mon époque, ce que j'ai connu de l'Iran. L'héroïne a 5 ans de plus que moi parce que je voulais qu'elle ait 18 ans au moment de la révolution pour vivre pleinement son amour. Ses lieux et ses manières de vivre sont les miens, car on écrit avant tout pour soi. Les gens s'étonnent souvent [de l'ouverture de la société qu'ils découvrent dans les romans], parce qu'on a une autre image de l'Iran.
Le changement social qui s'est effectué entre les années 50 et la révolution de 1979 a été très rapide...
Le parfum de l'innocence, c'est justement ces quartiers nord de Téhéran qui se sont construits très rapidement. Nous sommes dans les quartiers les plus occidentalisés de Téhéran, avec les gens les plus occidentalisés. L'héroïne, Elham, est née dans ces quartiers [en 1960] et elle croit que c'est l'Iran, alors qu'ils sont nés avec elle. C'est l'époque de ce qu'on appelle le «pétrodollar cool»: il y a de l'argent, et le roi veut faire de l'Iran la Suisse du Moyen-Orient. C'est un monde que la révolution a balayé complètement. Les élites du pays - aussi bien du côté du régime que des intellectuels - n'ont pas vu venir cette révolution. Ça montre à quel point ils étaient enfermés dans cette fascination pour l'Occident, avec un mépris pour le peuple et la tradition, et se sont coupés du pays.
Depuis la révolution, le conflit entre tradition et modernité est-il plus marqué en Iran?
Je crois - mais c'est une analyse très personnelle - que l'Iran a eu la chance d'avoir fait la révolution islamique il y a 40 ans, parce qu'on est aujourd'hui dans une période post-islamisation. Il y a eu la thèse, c'est-à-dire la modernisation hâtive du pays par les Pahlavi - les derniers rois de l'Iran; l'antithèse, qui a été la révolution islamique. Et pour moi, aujourd'hui, l'Iran est en train de faire la synthèse. Il faut donner encore de 10 à 15 ans à l'Iran, s'il n'y a pas de guerre ou d'intervention.
Aujourd'hui, 70 % des Iraniens sont des citadins, il y a des satellites partout - même s'ils sont interdits, beaucoup sont connectés à l'internet, et, assez paradoxalement, grâce à la révolution islamique, qui était quand même une révolution populaire, le taux d'alphabétisation atteint 93 %. L'Iran a construit des universités partout, et ç'a permis aux femmes d'être éduquées, ce qui est très précieux.
Dans les deux romans, il est question d'exil, mais de façon très différente. Dans le second, l'un des personnages dit notamment à sa petite-fille que l'étranger doit toujours revenir dans son pays. Est-ce que celui qui part peut s'épanouir loin de sa terre d'origine?
Dans le premier livre [où un couple de paysans quittent leur terre natale], c'est un exil presque biblique, alors que le deuxième parle d'une immigration plus contemporaine. Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux rester sur ses terres et s'épanouir dans sa culture. Mais quand on part, on vit des vies qu'on n'était pas censé vivre. On découvre des choses intenses. Je ne suis pas contre l'idée de partir, à ceci près qu'après, on devient des citoyens du monde. Et il y en a de plus en plus. Ces gens comme moi, ce qu'ils peuvent faire de mieux, dans l'état actuel des choses, c'est de bâtir des ponts entre les cultures, entre l'Orient et l'Occident. Il n'y a que nous qui puissions expliquer, raconter, rapprocher... d'autant plus qu'il s'agit finalement d'une civilisation très similaire et commune, dont les bases sont les mêmes. Et la littérature est un excellent moyen de rapprocher les gens.
Votre premier roman a été traduit en anglais et en italien. Est-ce que ce serait envisageable qu'il le soit en langue iranienne?
Un éditeur iranien m'a justement contactée récemment. Je crois qu'il n'y a rien qui empêcherait le premier livre d'être traduit, à part une scène d'amour qu'on pourra arrondir un peu, et il pourrait l'être bientôt. Mais pour le deuxième, je pense que c'est impossible!
La fin du Parfum de l'innocence laisse présager une suite. Y aura-t-il un troisième roman sur la période post-révolution?
C'est trop tôt pour parler de la période qui a suivi la révolution. Même si ça fait 40 ans, nous sommes encore habités par nos sentiments et nos ressentiments. Pour écrire objectivement, je pense qu'il faut attendre encore 10 ans. La tendance globale est de dire « nous sommes les gentils, ils sont les méchants ». Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a des nuances. Une révolution ne tombe pas du ciel, ce ne sont pas des barbares qui viennent envahir notre pays. Il y a des raisons et des responsabilités partagées. Mais j'ai un autre roman en tête sur lequel je vais commencer à travailler en attendant.
Une suite... indépendante
Le parfum de l'innocence, paru cette semaine au Québec, est la suite du premier roman de Parisa Reza (Les jardins de consolation), mais il peut également se lire de façon indépendante. On y découvre le Téhéran des années 60 et 70, de l'élite et des intellectuels, à travers l'enfance libre et l'adolescence privilégiée d'Elham jusqu'à ses 18 ans, à la veille de la révolution iranienne.
Propos Recueillis par Laila Maalouf








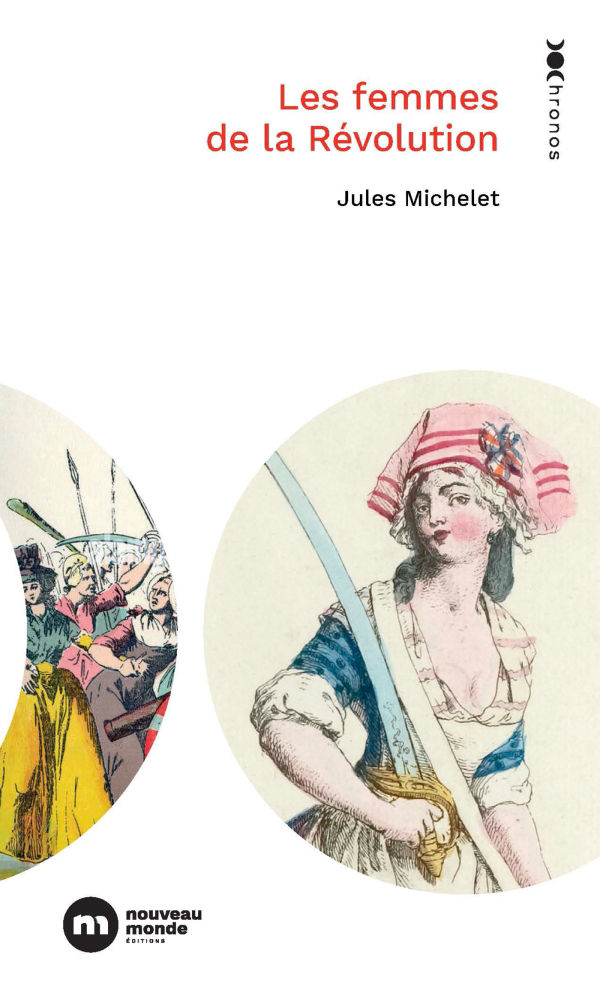













Commentaires